Nouvelle, in Des Soldats de Passage :
C’était la première journée ensoleillée après un hiver rigoureux. Un jour d’école comme un autre. La joie de retrouver les copains et ces bagarres dans la cour d’école semblables aux jeux des jeunes prédateurs. Elles étaient souvent assez violentes et il n’était pas rare que l’un de nous rentre à la maison avec quelques égratignures, quelques bleus, voire un œil au beurre noir. Ces « beugnes », témoins de nos coups étaient un peu nos médailles, arborés non sans une certaine fierté. Il peut, au reste, sembler étrange de nos jours que les instituteurs eux-mêmes ne nous aient que rarement punis, nous séparant mollement et ne nous gourmandant que brièvement. Il est vrai que la plupart des élèves était habituée à recevoir force « ramponeaux » de la part de leurs parents, et ce en guise de punition pour de bien enfantines turbulences. Ces pugilats puérils semblaient donc assez anodins. La guerre et son cortège d’horreur nous avait endurcis, et avait sans doute banalisé une violence quotidienne, perçue d’ailleurs comme dénuée de réelle gravité, puisque sans réelles séquelles. Nous avions nous-même vu tant de choses, qu’aucune de ces rixes ne nous troublait le moins du monde. En février, apogée de l’irruption de la violence dans notre petit monde d’enfants, nous avions assisté, médusés, au lynchage en règle d’un parfait inconnu pour nous, un dénommé Marsac, collaborateur supposé. Sa dépouille tuméfiée avait été accroché quelque temps à un panneau de signalisation devant la prison à quelques pas seulement de notre école. Je m’étais demandé quel pouvait être le crime de cet homme ? Avait-il pactisé avec les Allemands, avec quelque bourreau de la Gestapo ou en savait-il un peu trop sur d’autres personnes bien plus impliquées que lui-même dans les crimes commis pendant l’occupation, et dont on découvrait peu à peu l’existence. La foule, dont le soulagement était, selon mon père, plus que suspect, m’avait en tout cas laissé une sensation détestable de lâcheté, le pauvre homme ayant été massacré très opportunément avant son jugement. Les assassins étaient donc peut-être assez prudents. Bien d’autres violences impunies avaient jalonné les mois qui s’étaient écoulés depuis la libération, mais il n’était pas toujours bien vu de les désapprouver publiquement. Les haines ne s’amenuiseront que progressivement.
Les soldats qui avaient remplacé l’occupant étaient, eux-aussi, souvent à l’origine de rixes qui obligeaient leurs compatriotes à intervenir : des patrouilles de la « Military Police » américaine faisait, autant que faire se pouvait, régner l’ordre parmi ces jeunes hommes déracinés qui, à des milliers de kilomètres de chez eux, devaient affronter l’ennui, la solitude et pour certains d’entre eux le péril des combats. Dijon était désormais loin de la zone de front. Ces américains étaient principalement chargés de missions d’intendance. C’était, de nouveau, vu de Bourgogne, une « drôle de guerre », car des combats furieux qui se déroulaient désormais sur le sol ennemi, nous ne connaissions que peu de choses, et tout semblait être rentré dans l’ordre. Bien sûr, les communiqués triomphant des alliés étaient encore suivis avec une attention relative, mais la guerre paraissait si loin. Nos yeux d’enfants ne voyaient que ces nouveaux militaires, si différents des Allemands, qui semblaient dégourdis, un peu voyous, et qui nous gâtaient avec leurs inépuisables rations : chocolat, chewing-gum, biscuits, voire cigarettes… À l’école Voltaire nous exhibions souvent leurs petits cadeaux et n’hésitions pas à nous mettre de bonnes roustes pour mettre la main sur ces trésors du Far-West. L’un des autres sujets favoris de nos jeux de lionceaux était l’attitude de telle ou telle personne pendant la présence allemande, ou, depuis que les Américains séjournaient ici, le comportement des femmes demeurées seules et qui, il est vrai, parfois étanchaient leur soif de vie avec ces jeunes américains comme d’autres l’avaient fait avec des Allemands.
À la sortie de l’école je fus attiré par une dispute qui (peut-être l’espérais-je) tournerait en bagarre.
- Fait gaffe Roger ! T’as intérêt à m’en filer un, sinon, tous les gars vont savoir comment ta sœur elle se donne aux amerloques pendant qu’son bon-ami il est encore prisonnier chez les boches ! criait de sa voix aiguë mais tonitruante un marmot de ma classe qu’on appelait « le Raymond ».
L’autre gamin, peut être âgé de douze ans, fumait, l’air affranchi caché au coin de la rue devant une cordonnerie dont l’enseigne en ciment imitant une chaussure me fascinait.
- Fait gaffe à quoi ? Barre-toi p’tit mec ou j’t’en mets une à te décoller la tête ! Répliqua ce Roger après un long silence empreint de mépris.
- Aller ! File-moi un chouine-gomme. Autrement j’te jure que j’le dis à tout le monde et elle f’ra moins la maligne quand son chéri va rentrer.
- Fous-moi le camp… P’tit mec va !
Le gamin, sans hésiter et sans semonce se mit à frapper l’autre de toutes ses forces tant et si bien que ce fut rapidement l’aîné des deux qui se retrouva au sol, sa cigarette blonde à demi-fumée continuant de se consumer sur le pavé. Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, le marmot continua à faire pleuvoir une multitude de petits coups de poings que Roger, toujours à terre, éprouvait la plus grande difficulté à esquiver. Il finit par abandonner et concéder le tribut tant désiré. L’autre s’empara symboliquement de la blonde encore fumante et s’en alla, affectant une lenteur triomphante, tout en crapotant avec l’appréhension d’une toux qui trahirait qu’il n’avait jamais tiré sur une cigarette.
Je me rapprochai du vainqueur, un mioche de mon âge qui, sans être un copain était un camarade de mon école. Il me connaissait bien pour mon esprit volontiers bagarreur et me respectait pour cela.
- Eh ben! Tu lui en as foutu une dérouillée au Roger. Bath !
- Au moins il la fermera sa grande gueule. Va pas aller s’vanter de s’êt’ fait met’ chaos par un plus p’tit.
- Pour sûr!… C’est vrai pour sa frangine, elle est à la colle avec un Amerloque ?
- Ben oui qu’c’est vrai ! C’est mon grand frère qui l’a vu, elle se bécotait avec l’ricain sûrement un officier (il a une casquette avec un gros aigle doré, c’est pas un simple trouffion, c’est sûr), y paraît qu’c’est un pilote qu’est stationné à Longvic. Bah ! Tu parles d’une salope, faire cocu son bonhomme alors qu’il revient dans un rien de temps… Parce qu’en plus, les boches, y z’en ont plus pour longtemps à ce qu’y paraît. C’est mon frangin qui m’la dit.
Si je ne doutais guère que les Allemands n’en « eussent plus pour longtemps », j’avais, pour ma part, déjà appris à me méfier des ragots. Dans mon propre entourage, j’en connaissais qui, après avoir bien profité de la présence allemande en pratiquant un marché noir assez juteux, et qui n’avaient pas dédaigné pas la compagnie parfois galante de soldat de la Wehrmacht, s’adonnait désormais à toutes sortes de trafics avec nos alliés dont les moyens étaient bien supérieurs et la discipline infiniment plus souple.
- File-moi l’train conclut-il soudain, faut qu’je rentre chez mon Darron.
Je fis donc un détour pour continuer à discuter avec Raymond, enfant un peu vantard et peu scrupuleux, mais pour lequel j’éprouvais une certaine estime pour avoir triomphé d’un plus grand. Ses propos n’étaient pas ceux d’un enfant de dix ans, et l’air apache qu’il se donnait me ravissait. Je repris le chemin de chez moi après avoir atteint, en sa compagnie, le taudis qu’il habitait avec sa mère rue d’Auxonne, un rez-de-chaussée humide et insalubre dans une arrière-cour. Je remontai donc le boulevard Carnot, jolie voie bordée d’arbres qui commençaient déjà à bourgeonner. Bientôt à l’angle de la rue Jean-Baptiste Baudin où habitaient mes parents, j’entendis une moto qui me rattrapait à vive allure. Mon père adorait les motos, ces Terrot dont il avait eu plusieurs exemplaires successifs et qui, avant-guerre, avaient fait son bonheur en lui permettant de s’évader à la campagne avec quelques amis, motards eux-aussi. Le bruit caverneux du moteur n’était pourtant ni celui des 125 Terrot, ni de celui des motos allemandes. Je me retournai donc, curieux. C’était une grosse cylindrée vert olive montée par un soldat noir. Je regardai ce spectacle avec excitation. Le conducteur me fit, sans lâcher son guidon, un signe discret de la main tout en arborant un sourire amusé qui découvrit une alignée de dents aussi blanches que régulières et qu’encadraient les sangles de son casque flottant au vent. Comme il s’éloignait, je ne quittais pas des yeux la machine. Soudain, sortit de notre rue la longue carriole hippomobile conduite par un gros homme rougeaud prénommé Paul et qui servait au transport des Terrot de l’usine jusqu’à la gare Porte-Neuve. Le gros cheval de trait, un animal que je connaissais bien, d’ordinaire calme et docile, effrayé par le vacarme du moteur pétaradant du deux-roues se cabra et l’américain eut un réflexe malheureux. La roue arrière perdit son adhérence et le malheureux roula sur les pavés jusqu’à la bordure du trottoir de l’autre côté de la chaussée tandis que son casque oscillait sur le croisement après une course folle. Quand j’atteignis en courant le lieu de l’accident, son corps inanimé était déjà entouré d’une petite foule venue lui porter secours, mais en vain. Son crâne ouvert, qui avait éclaté son la violence de l’impact, laissait voir sa cervelle dont le gris clair contrastait singulièrement avec sa peau d’un noir prononcé. En peu de temps d’autres curieux s’étaient agglomérés et c’était désormais au moins une trentaine de personnes qui regardait le malheureux sans réagir.
- Gaston ! ben va prévenir les Américains ! Vociféra une grosse femme en tablier fleuri.
Le mari, un petit homme au visage émacié, s’exécuta à pas lents en maugréant, allumant ostensiblement une américaine pour montrer qu’il n’obéissait pas à sa femme.
- Dépêche-toi, non de Dieu ! Bougre de traine-savate ! renchérit-elle.
Le bonhomme accéléra le pas déclenchant un ricanement chez l’une des commères présentes, qu’elle étouffa bien vite en se rendant-compte qu’il était peu de circonstance. Ma mère arriva bientôt et m’entraina par le chandail jusque chez moi contre mon gré.
Mon père avait, depuis quelque mois repris, en plus de son travail salarié à l’imprimerie Darantière le petit café à l’angle de la rue et de la cour au fond de laquelle nous habitions. Je regardais depuis la fenêtre du troquet l’attroupement qui m’empêchait désormais d’apercevoir le malheureux soldat. Au bout d’un temps fort long, un gros véhicule vert olive frappée d’énormes croix rouges apparut précédé du retentissement tonitruant de sa sirène. Il se fraya un chemin parmi les curieux. Deux hommes coiffés de casques aux mêmes croix rouges en bondirent et en tirèrent un brancard. Comme ils allaient évacuer le corps, un autre véhicule analogue accompagné d’une jeep de la police militaire arriva. Ses occupants en salopettes verdâtres se hâtèrent de charger le bolide sur le plateau et, à peine les ridelles remontées, s’en furent sans un mot. L’évacuation n’avait duré que quelques minutes et il ne resta plus du tragique événement qu’une flaque de sang dont la sciure épandue commençait déjà à masquer la présence. La foule se dissipa donc et chacun retourna à son activité routinière exceptés deux compères. Il s’agissait sans doute d’ouvriers car ils portaient tous deux des bleus de travail sous leurs canadiennes aux couleurs fanées. La petite cloche de bronze au-dessus de la porte retentit et les hommes entrèrent dans le café.
- Salut la compagnie !
- Bonjour m’sieurs dames ! surenchérit l’autre. Eh ben ! l’pauv’type il l’a pas vu v’nir celle-là ! Sûrement qu’y f’sait l’con sur sa bécane. Y roulent à tombeau ouvert ! ça d’vait arriver… L’Paul, il est pas dans l’pétrin ! Les ricains l’ont embarqué pour l’interroger sur les circonstances de l’accident. J’aimerais pas être à sa place !
- Bon aller, ça va Gaston… Deux blancs limés s’te plait Lucienne… Et sans faux col !
Ma mère les servit, et les deux verres furent avalés presque d’un trait.
- Ah ! ça décrasse cré’non de Dieu, s’exclama le Gaston en question après s’être râclé bruyamment la gorge.
- L’Désiré, l’est pas là ? Faut qu’on lui cause… Reprit l’autre, l’air important.
- Non, il travaille à l’imprimerie en journée, vous savez bien… répondit ma mère agacée. De quoi s’agit-il ?
- On cherche une combine pour avoir des sèches, des américaines f’ront l’affaire. On avait une accointance avec une bonne femme à la manufacture des tabacs, elle s’est fait piquer cette conne !
- Ouais avec l’tablier plein d’clope. Elle est lourdée. Compléta l’autre.
- Et qu’est-ce-que vous voulez qu’on y fasse ?
- Ben comme les ricains viennent ici, et qu’y z’ont plein de clopes de rab’, on a pensé que peut-être…
- Taratata, on ne fait pas dans le marché noir.
Le dénommé Gaston rigola.
- Peur des condés ? Ouais, ben parles-en quand même au Désiré, tu s’ras gentille…
Ma mère lui jeta un regard noir.
- Bon aller on r’tourne au turbin. Salut tout le monde.
Un des clients, un habitué avait entendu la conversation tenue à très haute voix.
- Excuses-moi Lucienne, mais tu sais, y’a pas mal de monde qui s’rait intéressé. Tu d’vrait y réfléchir, les amerloques y’s’en ont plein d’clopes de rabe et pas que ça…
Ma mère le rabroua assez sèchement mais je devinais que sa remarque ne l’avait pas laissée indifférente.
Quand mon père rentra, elle commença donc à lui narrer l’échange. De prime abord, il ne voulait pas en entendre parler, arguant qu’il risquait d’y avoir des complications pour un bénéfice bien faible. Le même client se mêla à nouveau de la conversation.
- En fait, Désiré, tu sais, y’a bien d’autres cafés qui vendent, des américaines. Y’a moyen de se faire de l’argent.
- Oh moi l’argent… répondit mon père pensif.
- Oui, j’sais bien… Mais pense au moins qu’ça dépanne les gens du quartier. Avec c’te pénurie. On sait pas quand ça va finir. Au bistrot rue d’M……….. y sont en ch’ville avec les Amerloques… ça marche du feu de Dieu.
- Je ne veux pas d’ennui avec les flics. Ils ont déjà été assez menaçants quand ils sont venus perquisitionner à la recherche d’armes. Quand ils ont trouvé le fusil boche… Je me suis fait bien remonter les bretelles ! On a eu vite fait de se débarrasser du reste…
En effet, quelques mois avant, mon père et moi étions allés, après la visite de la police jeter dans l’Ouche un grand nombre de cartouches de mitrailleuse ainsi que les cartouchières du fusil. La police avait heureusement fermé les yeux sur la détention d’arme prohibée, la chose étant à ce point courante, que ne se trouvaient vraiment poursuivies que les personnes qui en auraient fait usage.
Ce même client se fit insistant :
- Bon, écoute Désiré, moi j’comprends bien qu’tu hésites, mais je te propose d’aller voir la Raymonde qui tient l’café rue d’M……. J’lui demande à qui qui faut s’adresser. J’te mets en contact après ce sera à toi d’voir.
- Discuter on peut toujours, ça n’engage à rien dit mon père indécis pour clore la discussion.
Tôt le matin, le lendemain, le café à peine ouvert, Paul l’employé de l’usine Terrot, poussa la porte. Cet homme rond et rougeot, assez âgé, peut-être la soixantaine avait une mine déconfite. En dépit de la fraicheur matinale il suait comme s’il avait couru.
- Eh ben ! Vous parlez d’une histoire. J’suis pas dans les emmerdes.
- Oui, on a vu ce qui est arrivé hier. Le pauvre homme… Fit ma mère. Enfin, au moins tu n’as rien eu…
- Un aligoté, s’te plaît !
- Et les Amerloques M’sieur? Ils vous ont dit quoi quand ils vous ont emmené. Demandai-je avec une gaité peu en rapport avec la situation.
- Euh… Ils voulaient me poser des questions sur les circonstances de l’accident. Répondit le gros homme décontenancé en me dévisageant. Puis il reprit sont récit en cherchant ses mots, s’adressant à ma mère. En fait, j’avais l’impression qu’y voulaient savoir pourquoi qu’y s’est beugné l’nègre, avec un officier et tout l’tintouin. Au début, j’en m’nais pas large… Oh ! j’croyais bien qu’y pensaient qu’j’l’avais fait exprès. Non de Dieu ! Ils ont même demandé quels rapports j’avais eu avec les frisés pendant l’occupation. Bah tu parles… Des rapports avec ces salauds-là. Mais c’est qu’y z’ avaient l’air sérieux. Non ! J’en m’nais pas large, j’te dis. Un moment j’me suis vu d’vant l’peloton d’exécution… Et pi… J’me suis dit…allez mon Paul c’est pas les Boches, non plus… Tu risques trop rien. T’as rien fait. Avec les ricains, comme t’as rien à te reprocher… Faut y dire, en plus, y roulait quand même vite ce con… Bon, enfin y m’ont tenu bien deux bonnes heures… Pi y m’ont r’lâché. Mais j’vais encore être convoqué chez les poulets. J’suis pas sorti d’l’auberge.
- Allez, vous en faites pas, Paul, ça ira, de toutes façons, je pense qu’il y aura des témoins pour expliquer comment les choses se sont passées.
- Moi en tout cas j’ai tout vu ! m’écriai-je. L’Amerloque c’est vrai qu’il roulait à toute berzingue. Juste avant de tomber il m’a souri, m’a fait un petit signe de la main et puis la jument a eu peur elle s’est cabré et la moto est tombée. J’ai couru, le pauv’gars était mort.
- Ben oui la pauv’bête, c’est l’bruit du moteur qui lui a fait peur. Reprit Paul, comme s’il avait oublié l’américain, en me fixant avec des yeux tout ronds. Ah, cré’nom de Dieu. Quelle histoire ! Lucienne, r’mets m’en un p’tit pour la route, j’en ai ben b’soin.
Paul s’empressa de vider son verre d’un trait, puis prit congé l’air toujours aussi désemparé. Je le regardai par la fenêtre comme il retirait de la tête de la jument rassasiée la musette de jute remplie d’un picotin avec des gestes machinaux. Campée fermement sur ses fortes jambes, la grande bête musculeuse qui avait retrouvé sa placidité habituelle, était presqu’aussi immobile qu’une statue. Seules ses oreilles remuaient involontairement au-dessus des grandes œillères de cuir noir craquelé. Elle avait manifestement oublié sa frayeur de la veille, ignorante des conséquences dramatiques de son affolement. Paul fit un bref « hue » et le long charriot chargé de motos rutilantes s’ébranla en direction de la gare de marchandises, accompagné par le claquement cadencé des énormes sabots ferrés sur les pavés.
C’était jeudi et je profitai de ce jour sans école et de la douceur printanière pour me plonger, assis sur le toit de l’immeuble, dans la lecture d’un de ces livres d’aventure qui me captivaient désormais. La matinée passa donc rapidement et, comme j’achevais mon livre, j’entendis les cloches de Saint-Michel qui annonçaient midi et le retour de mon père. Je descendais donc en repassant par le vasistas, quand un bruit ronflant de moteur se fit entendre dans la cour. Je passai la tête par la fenêtre entr’ouverte de l’escalier : un énorme camion bâché manœuvrait péniblement. Je pressai le pas. Quand j’arrivai un grand soldat se tenait déjà à côté du véhicule.
- Hey ! Somebody’s in ?… Hi, kid ! I’m looking for Mr. Désiré. Is he in ?
- Pas parler anglais.
- O.K. Obviously. Je… ‘chercher Monsieur Désiré. Est-ce-que c’est son maison ?
- Oui, Désiré Béhin, c’est mon père.
- Well, So ? Lui ici ? Je voudrais parler à lui.
- Non, mais il va arriver d’une minute à l’autre.
- Don’t understand… What ?
- Il vient, fis-je en accompagnant ma réponse de gestes exagérés. Bientôt…
- Fine. Conclut-il l’air emprunté en me tendant quelque chose. Chewing-gum, kid ? Wan’it ?
Un peu intimidé je pris la sucrerie qui trônait au centre d’une immense main dont la paume rose contrastait avec la peau d’un noir délavé du militaire. Vêtu d’une sorte de salopette tachée d’huile ce jeune américain à la taille surprenante paraissait un peu perdu dans cette petite cour inconnue. Pour se donner une contenance, il me sourit en silence, essayant probablement de rassembler quelques mots de français pour me dire quelque chose mais une sorte de timidité l’empêchait de se lancer. Sur ces entrefaites mon père qui rentrait pour le déjeuner s’arrêta à l’entrée de la cour.
- Bonjour ? C’est pour quoi ?
- Oh ! Hello, you’re presumably Mister Désiré, aren’t you ?
- I, Mr Behin, yes répondit mon père en se désignant d’un geste vague.
- O.K. . I’m corporal Markus, I ‘ve got the cigarettes you ordered.
- Euh… I no speak english.
- Je… camion beaucoup cigarettes… for you. American ones… Camel, Lucky Strikes.
- Oui, cigarettes et…
- Pour vous… Tobacco, yes ? You odered ? Acheter ?
- Non pas acheter.
- But, you odered, no ? Interrogea le soldat avec un soupçon de surprise.
- J’en ai parlé avec un client, mais je ne sais pas si je veux en acheter… Je n’ai pas pris de décision.
- No, no, Misses Raymonde told me you intended to buy’em. Sellin’ the whole truck. L’américain souleva la bâche découvrant un plateau rempli de boîte en carton.
- Comprends pas.
- Mam’Raymonde dit vous acheter cigarettes, pour vendre.
- Ça fait beaucoup…
- Yes, beaucoup… Much money to get ! You may get the whole truck. If so, you may keep the GMC too, if you please. Je donner le camion aussi si vous acheter tous les cigarettes.
- Le camion ? euh…
- Yes, it’s a good deal, besides, as you’re a nice fella, I give you… this ! Add it for free, if ye get the whole lot! – Il posa un gros pistolet automatique sur la ridelle abaissée. – Colt 1911 A1. Best gun in the world ! Military issue, brand new ! Honest, eh ?
- No, no… pas pistolet ! Interdit, ferboten…
- Yeah, I know, for sure ! Forbidden… Répliqua l’américain amusé. It’s a gift ! Never been used. brand new !
- Non, too dangereux. Police très vigilante maintenant…
- Police ? – à ce mot, il partit d’un rire tonitruant et d’ajouter en marmonant – I see, ye’re a bit o’ a coward… O.K. old man ! Never mind. As ye please. So what about the cigarettes ?
- Euh… Je ne sais pas peut-être un carton ou deux… One or two…
- Hey ! You’re kidding, aren’t ye old man ! No way ! The whole as a lot ! Mam’ Raymonde…
- No. Interrompit mon père sèchement, soudain très agacé. I… moi pas demandé cigarettes. Juste parlé… Acheter deux cartons, pourquoi pas. C’est tout. Connais pas « Mam Raymonde »… Enfin juste de nom…
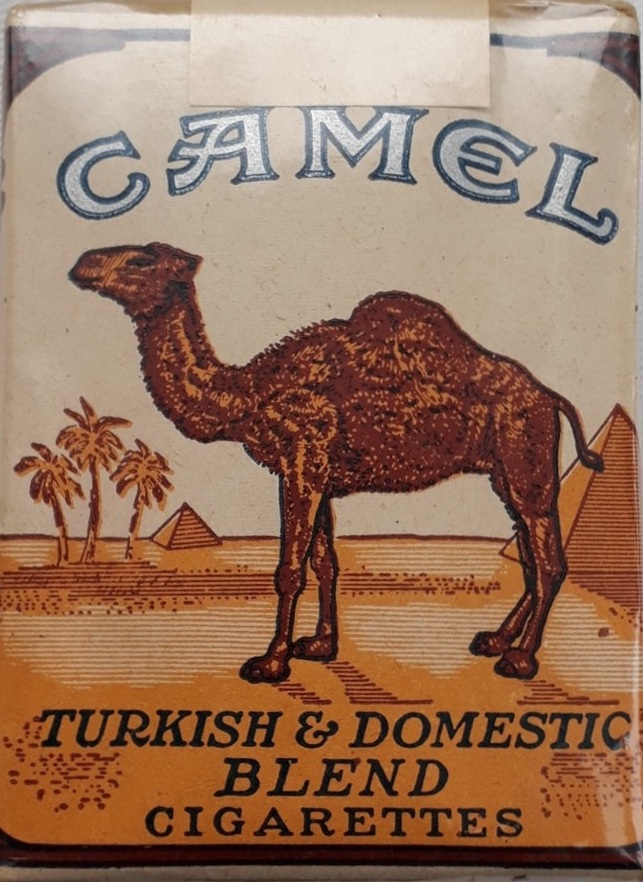
Le caporal parut très contrarié. Il fixait mon père avec des yeux noirs exorbités et avait tout à fait effacé son sourire.
- You bloody Frenchies… Always acting crazy. Marmona-t-il, puis se faisant menaçant : O.K. Vous faire attention. Pas une façon faire des affaires… Enfin d’ajouter avec un sorte de sourire moqueur en balançant ses immenses bras de gauche à droite et de droite à gauche : Oui… Non… Je ne sais pas… Make up your mind ! Quick !
- Comme je vous ai dit : deux cartons…
Les palabres durèrent encore un petit moment. Comme mon père tenait bon et refusait de se laisser intimider, son interlocuteur finit par se radoucir et essaya de vendre ce qu’il pouvait. En bon négociateur très persuasif, il parvint à vendre malgré tout cinq ou six caisses de blondes. L’affaire conclue et le prix payé, il se calma tout à fait agissant soudainement à nouveau de manière familière et appelant mon père « my friend ».
- Désiré ! Tu sais que le déjeuner est prêt depuis au moins vingt minutes ! interrompit ma mère visiblement très irritée.
- Oui, j’arrive… tu vois bien que je discute avec Monsieur !
- Ah ! lunch time, eh ? Have to go ? Understood, fit l’américain en clignant de l’œil d’un air amusé et entendu. Mam’ pas contente contre vous. Yeah, got it.
- Yes, je dois « go »… Mais si vous voulez boire un verre, je vous l’offre au café. OK ? Il mimait pour se faire comprendre.
- Yeah ! A drink ? Great ! Kind o’ ye, ma friend. Cheerio, old man ! Hey ! Let me know, if ye wan’further stuffs ! O.K. ? Can get anythin’ ye’d lust.
Mon père se hâta d’entrer chez nous car il devait bientôt repartir pour l’imprimerie, mais intrigué par le soldat, je résolu de le suivre discrètement dans le café.
- Hi Mam’. Have ye got bourbon ?
- Quoi ?
- Whiskey ? …. Er… Avoir ouiski ? ajouta-t-il avec application.
- Non, on n’a pas cette denrée-là.
- Somethin’ strong then ? Fort…
- Euh… Un marc ?
- D’know… Let’s try… « marr » !
L’américain fit cul sec.
- Yeah… Fuckin’good, actually… another one, s’il vous plait Madame.
En peu de temps, il but au moins un quart de la bouteille, ma mère n’osant pas vraiment arrêter de resservir cet homme à la stature impressionnante qui ne comprenait guère le français. Soudain ma mère s’aperçut de ma présence.
- Guy ! qu’est-ce-que tu traînes encore là. Je croyais que tu déjeunais avec ton père ! File-moi là-haut !
- Hey Mam ! don’t be harsh to him ! He’s a smart boy, eh… Hey, petit… come ! Milk chocolate… american… Toi, juste comme… my youngest brother in New-York… Guess you’re a clever boy, aren’t ye.
- Merci m’sieur !
Je remontai bien vite l’escalier.
- Papa ! c’est un vrai gangster américain ? Comme Al Capone ?
Mon père esquissa un sourire.
- Non je ne crois pas. C’est seulement un jeune soldat qui essaie d’améliorer son quotidien et de gagner un peu d’argent.
- Mais… il les vole, les cigarettes, pour les revendre.
- Disons qu’il les détourne… Je crois qu’ils en ont tellement…
- Et le camion ? Oh ! tu aurais dû le prendre il est magnifique !
Mon père éclata de rire devant ma naïveté.
- Et que veux-tu que je fasse d’un énorme camion militaire… Je n’ai pas même le permis. Et puis, tu crois vraiment que je pourrais le laisser au vu et au su de tous dans la cour sans avoir de problème. Pour le coup, je gage qu’il est volé, je ne pense pas que l’armée américaine donne son matériel aux hommes de troupe.
- Et le pistolet, il a dit qu’il te le donnait…
- Oui, certes… Tu ne crois pas qu’on a déjà eu suffisamment de chance avec le fusil boche… La police aurait pu nous faire de gros ennuis, tu sais. Au moins une amende…
- On peut le cacher, non ?
- Mais que veux-tu en faire de toute manière…
- J’aurais bien aimé le garder. Déjà que l’an passé j’ai échangé la baïonnette boche.
- Tu as bien fait. Et puis au moins on a eu du sucre pendant un moment
Les objections de mon père n’effaçaient pas ma déception. Si j’avais pu, je crois que j’aurais tout acheté. Je me disais en mon for intérieur que j’aurais sans doute trouvé aisément un moyen de vendre les cigarettes. Ce camion était si beau, et cette grosse arme si fascinante. Mon esprit était en ébullition. Sans avoir aucune idée de la vie concrète des gangsters, mêlant nos jeux d’enfants à l’étrange réalité qui était la nôtre, je me m’imaginais un instant déjà être un bandit, héros d’un roman ou d’une bande dessinée, à la tête d’un gang, gagnant un argent facile, vêtu d’un beau costume d’alpaga et coiffé d’un borsalino.
Avant de repartir à l’imprimerie, mon père me tira de ma rêverie puérile.
- Dis-moi Guy ? Tu n’as pas de devoirs à faire ?
Ce retour brutal à mon quotidien d’écolier me fit sourire. Nous étions loin de Chicago et j’avais neuf ans. Les Américains repartiraient bientôt et la dernière page de ces années hors du temps se refermerait sur un monde enfin en paix, cette paix dont je n’avais presqu’aucun souvenir, moi qui avais quatre ans en 1940.



N’hésitez pas à me laisser un commentaire, une suggestion ou un avis.